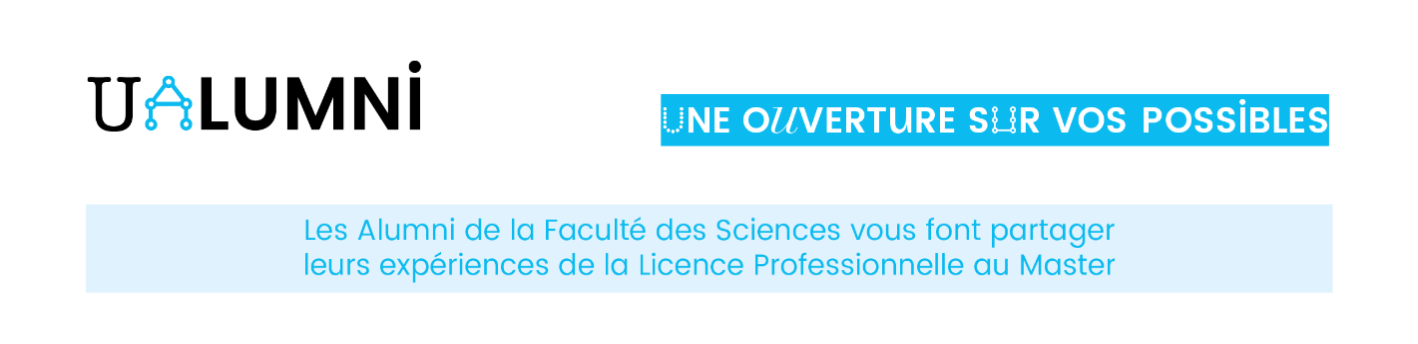- >Accès directs
- >Facultés et instituts
- >Faculté des sciences
- >Formations
- >Témoignages
- >Karim CHKIOUA - Alumni en écologie
Karim CHKIOUAAlumni Master EEZH
-2_343x193.jpg)
Un rêve d’enfant qui se concrétise
Karim est rentré en licence BOP (Biologie des organismes et populations) à la Faculté des Sciences en 2004 : « J’ai toujours su que je voulais faire de la science, les sciences du vivant, depuis tout petit. C’est vrai qu’il y a souvent cet héritage des enfants qui regardent des documentaires animaliers et qui veulent faire ça et… je l’ai fait ! » s’amuse-t-il.
Une fois sa licence en poche, Karim arrête momentanément ses études. Il reprend un Master EEZH (Écologie et Éco-ingénierie des Zones Humides, aujourd’hui devenu le Master Biodiversité, Écologie, Évolution) en 2011 à la Faculté des Sciences. Une solution pragmatique, Karim étant devenu papa, mais également une suite logique à son parcours : « Je viens d’Anjou, du Val de Loire, je suis né à Angers, et l’environnement là-bas est bercé par les fluctuations de la Loire, par les rivières et les zones humides. C’était naturel finalement de poursuivre là-dedans ».
Bien que Karim se soit plu dans cette formation « très familiale », où « on a été très proches entre nous, mais aussi avec les enseignants », il déplore néanmoins une formation un peu trop théorique : « Lorsque j’étais arrivé en M1, j’avais été impressionné par le fait que ceux qui arrivaient notamment de licence pro avaient des compétences naturalistes assez pointues, ceux qui arrivaient de BTS aussi, c’est typiquement le genre de choses qui nous manquaient et que beaucoup d’entre nous avons dû améliorer de notre propre initiative ». Depuis, le Master a été revu pour mieux répondre aux attentes.
Karim peut enfin s’adonner à sa passion du terrain grâce aux deux stages obligatoires en Master. En M1, il réalise un stage au Muséum d’Histoire Naturelle sur les populations d’écrevisses invasives en Anjou. Puis, en M2, son stage de fin d’année est consacré au diagnostic environnemental des annexes de la Loire avec une focalisation sur les populations de brochet, au sein du conservatoire des rives de la Loire
Un début de carrière en France aux expériences plurielles
7 ou 8 mois après le Master, le jeune écologue trouve un poste de chargé de mission zones humides dans l’Association Nature du Nogentais dans l’Aube. Ses missions relèvent de la coordination de projets, de la gestion, restauration, et de la conservation axée sur un milieu : les zones humides. Au bout de six mois, l’association propose à Karim de les rejoindre, mais il refuse et rentre en Anjou.
« J’avais un projet qui me taraudait déjà depuis de nombreuses années, c’était de travailler à mon compte avec d’autres collègues géographes, écologues, naturalistes afin de faire du diagnostic environnemental, inventaire faune flore, études d’impact…». Karim s’associe alors avec ses collègues au sein d’un bureau d’études. Un système qui, au fil des années, trouve ses limites : « c’est moins satisfaisant que le travail dans le secteur associatif ou le secteur public, c’est du travail qui paye mieux mais qui n’est pas satisfaisant humainement ».
Karim met un terme à leur collaboration, mais continue à travailler à son compte. Il réalise des formations sur le thème de l’écologie, la gestion des écosystèmes, et créé des MOOC sur la gestion de la biodiversité pour une entreprise lyonnaise, Digischool.
Un parcours qui s’étoffe en Outre-Mer et à l’international
La vie est faite de coïncidences et d’opportunités, des portes s’ouvrent quand d’autres se ferment. C’est ainsi que, en 2018 – après avoir été contacté par un ami de licence – Karim s’embarque pour la Nouvelle-Calédonie afin de co-fonder une structure pour faire de la recherche, de la conservation, de la sensibilisation du milieu aquatique. L’association Vies d’Ô douce est créée, qui est aujourd’hui la structure de référence dans le Pacifique Sud pour les eaux douces.
Karim précise : « Ça n’existait pas à l’époque, c’est surtout le lagon qui était étudié et protégé. Malgré tout […] il y a un taux d’endémisme qu’on ne trouve nulle part ailleurs, la Nouvelle-Calédonie fait partie des rares hotspot de biodiversité dans le monde avec l’Amazonie notamment ».
L’association, dont l’objectif principal est de valoriser la biodiversité des milieux dulçaquicoles, s’attaque à de nombreux projets. Parmi eux, le projet de conservation d’un petit poisson (galaxias néocalédonicus) très rare, endémique de Nouvelle-Calédonie, menacé par l’artificialisation des milieux et l’introduction d’espèces envahissantes comme le black bass.
Second projet phare, le projet d’amélioration de la connaissance de l’ichtyofaune de Nouvelle-Calédonie via un inventaire de la faune des eaux douces du pays (presque 80 rivières échantillonnées sur l’ensemble du territoire).
« En travaillant en Nouvelle-Calédonie, fatalement j’en suis arrivé à m’intéresser aussi aux milieux marins, notamment pour la capture de poissons tropicaux pour les aquariophiles en Europe. C’est cette ouverture sur le milieu marin qui m’a permis d’avoir une première expérience en 2019 en Grèce, avec une association qui s’appelle Archelon sur les tortues caouannes en méditerranée. »
En 2020, Karim souhaite repartir en Nouvelle-Calédonie, mais la COVID pointe le bout de son nez : les postes à l’international ne sont plus possibles. Pendant un an et demi, Karim continue de travailler depuis chez lui avec Vies d’Ô douce, et il enseigne en parallèle la biologie et l’écologie en France.
Lors de la réouverture des frontières, Karim obtient un poste à la coordination du Plan National d’Actions Tortues Marines en Guyane pour l’OFB (Office Français de la Biodiversité) : « J’assiste la coordinatrice locale donc j’apprends quel est ce métier de coordinateur du plan d’action tortues. ».
Après un an à ce poste, Karim obtient un poste de coordinateur cette fois en Nouvelle-Calédonie au sein de l’Agence Néo-calédonienne de la Biodiversité : « Je me lance, j’ai l’expérience d’un plan d’actions, j’ai l’expérience de la Nouvelle-Calédonie, j’ai l’expérience des tortues, donc je me dis que je corresponds parfaitement, et j’ai le poste ! Je passe deux mois en France après mon retour de Guyane et je redécolle immédiatement pour la Nouvelle-Calédonie. »
Les prérogatives de l’Agence Néo-calédonienne de la biodiversité
L’Agence Néo-calédonienne de la biodiversité basée à Koné compte actuellement 19 agents. Elle est divisée en 3 pôles :
- Le pôle marin : y sont gérés l’initiative « récif résilient » qui traite de la conservation et de la recherche sur les récifs coraliens, la gestion du bien UNESCO (une grande partie du lagon calédonien est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), la coordination de l’Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR), ainsi que les plans d’actions dugong d’une part, et tortue, dont s’occupe Karim, d’autre part.
- Le pôle terrestre qui se charge de la gestion et conservation des forêts sèches, l’un des écosystèmes les plus rares et menacés dans le Pacifique Sud.
- Le pôle menace qui s’occupe notamment de la gestion des espèces exotiques envahissantes telles que le cerf et le cochon sauvage.« À ce jour il y a 4 à 5 fois plus de cerfs en Nouvelle-Calédonie que d’êtres humains ! » s’exclame Karim.
L’Agence travaille également à des actions transversales de conseil, coopération, communication ou sensibilisation à destination du grand public ou des écoles (ex. : dernièrement, mise en place d’une application sous forme de jeu memory sur le site du Centre d’Initiation à l’Environnement).
Les missions de Karim en tant que coordinateur du Plan d'Actions Tortues à l’ANCB
« Concrètement, moi j'essaie d'être au centre de tout ce qui se fait – l’intégralité des projets de recherche, conservation et préservation – autour de la tortue marine. Le travail à la coordination d’un plan d’actions tortues réunit un certain nombre d’acteurs (ONG, Université de Nouvelle-Calédonie, organismes de recherche comme l’IRD, l’Aquarium des lagons), les collectivités (3 provinces) le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et l’Etat français matérialisé par le Haut-Commissariat. Chacun a des problématiques différentes vis-à-vis de l’environnement […] Il faut composer avec tout ce petit monde. »
Le plan d’actions, qui est un document d’objectifs, réunit 86 actions classées en 5 grands axes : l'amélioration des connaissances, la protection des tortues marines, la protection de l’habitat, la sensibilisation et la communication, la gouvernance et la coopération internationale. Au quotidien, son exécution se traduit au travers de plusieurs actions saisonnières.
« D’octobre à mars c’est la saison des pontes et émergences. Une grande partie du travail va être de suivre les missions de suivi des pontes, suivi des traces, suivi des émergences sur les sites de pontes ».
«En mars, avril, mai mon quotidien c’est l’émergence de projets à venir liés à la connaissance car si on connait bien les tortues qui pondent, on connaît très peu les juvéniles qui se baladent dans le lagon ». Cela s’est par exemple récemment traduit par des réflexions autour de suivis de drones pour le comptage. De plus, L’ANCB étant un GIP, elle n’a pas de financements propres. Une grande partie du travail de Karim consiste à trouver des fonds.
« De mai à octobre, c’est la période creuse, l’hiver austral, on formalise les projets à base de fiches projet budgétées ». En ce moment, Karim développe un projet de bancarisation des données – une application de terrain à destination des collecteurs.
Le Plan d’Actions Tortues participe également à une continuelle veille réglementaire et juridique autour de la conservation des populations de tortues marines. Qu’il s’agisse de participer à des discussions avec les autorités autour du statut de protection des tortues et de leurs habitats, ou encore de la question du droit coutumier au prélèvement dérogatoire de tortues marines dans le cadre de cérémonies (si toutes les espèces de tortues marines sont protégées en Nouvelle-Calédonie, un droit particulier s’applique aux populations canaques qui peuvent capturer et consommer la tortue verte dans certains cadres coutumiers relevant de spécificités culturelles traditionnelles), il faut se tenir au courant et collaborer en bonne entente avec les différents acteurs du territoire.
À travers ces nombreux projets, Karim met ainsi en œuvre un large spectre de compétences. Il évoque d’ailleurs que les cours de SIG, les études de cas en bio-géographie, qui étaient « très pratiques » et l’ont aidé « à mettre en perspective les choses, à penser les choses de manière systémiques » et l’anglais scientifique sont des compétences qui lui ont été utiles durant son parcours professionnel.
Ses conseils alumni
« Je pense que le meilleur conseil que je pourrai donner c’est s’enlever de la tête qu’il n’y a que des parcours verticaux, que les étapes se prennent l’une après l’autre […] il y a plusieurs moyens d’arriver à ces objectifs. Parfois une porte se ferme et une autre se rouvre. C’est toujours possible de s’en sortir avec un parcours qui n’est pas forcément vertical ».
« Un autre conseil que je donnerai c’est de ne pas hésiter à se former soi-même : faire du naturalisme, faire du bénévolat pour des associations environnementales, lire des guides naturalistes, faire du SIG de son côté, se tenir à l’affût des actus, et puis il faut aussi ne pas hésiter – même si ce n’est pas forcément possible pour tout le monde – à être mobile. La gestion environnementale ce n’est pas uniquement les eaux douces de l’Anjou, pour mon expérience le monde est vaste ! ».